L'émergence de nouvelles maladies
Une nouvelle maladie infectieuse fait son apparition chaque année dans le monde et tous les cinq ans, l'humanité subit une crise majeure due à l'émergence ou à la réémergence d'un virus. Au cours des trente dernières années, 35 nouvelles maladies infectieuses ont émergé à travers le monde : VIH, virus grippal H5N1, virus Ebola, virus Nipah, Tuberculose, maladie du sommeil, Paludisme, etc… Alors que certaines font cycliquement la Une des médias, d’autres sont passées sous silence, ou presque. Cette médiatisation entraîne un décalage entre menace et réalité. Pour preuve, l’épidémie du sida à laquelle nous sommes confrontés depuis 25 ans inquiète guère le public malgré les mutations imprévisibles du virus. Mais revenons au vif du sujet et cherchons quels sont les facteurs de l’émergence de nouvelles maladies infectieuses.
L’émergence de nouvelles maladies infectieuses est due à de nombreux facteurs. Certains influent sur la transmission des pathogènes, comme les modes de transports et les rassemblements, et d’autres influent sur la virulence des pathogènes, comme les systèmes de santé et l’accès aux soins d’urgence. Les dix principaux facteurs sont :
- les changements des pratiques agricoles et agronomiques, les changements d’usage des sols qui sont la cause notamment de l’infection à virus Nipah en Asie du Sud-Est. Cela comprend :
· la déforestation devenue massive (Amazonie, Indonésie, Madagascar, Afrique tropicale) qui favorise le contact entre l’homme et les arbovirus qui autrefois étaient abrités dans les grandes forêts humides équatoriales. De plus, cela favorise le rapprochement de l’homme et des grands singes qui sont le vecteur des virus du Sida ou de la fièvre Ebola. Enfin, la menace de contamination humaine est augmentée par la consommation de viande de brousse par les ouvriers.
· l’élevage intensif d’animaux (poulets, cochons, ruminants, poissons) qui est à l’origine de nombreuses épidémies qui se sont développées ces dernières décennies : grippe H5N1 en Chine, grippe H1N1 au Mexique…
· les déplacements d’hommes et d’animaux entre les espaces urbains, agricoles et naturels (notamment les forêts adjacentes aux habitations) qui favorisent le développement de maladies infectieuses. En effet, en France la maladie de Lyme (transmise à l’homme par les tiques) a pour origine la reforestation et la pullulation des rongeurs et cervidés.
- les changements démographiques, sociétaux et comportementaux (la population se rassemble dans de grandes mégalopoles, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes) sont une des causes de la coqueluche humaine, du VIH et de la syphilis. La plupart des territoires urbains situés dans les pays du Sud sont source de potentielles explosions virales, comme le montre la carte ci-dessous les populations rurales et urbaines seront toutes à proximité de zones marquées par une forte biodiversité ou occupées par la faunes sauvage d’ici à 2030. Cette concentration urbaine de la population mondiale a pour conséquence une circulation plus rapide et plus intense des éléments pathogènes et de nouvelles immunités de certaines maladies.
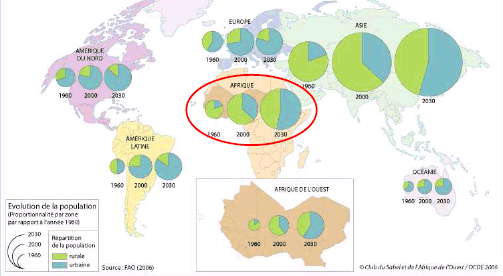
REPARTITION DE LA POPULATION DE 1950 A 2030
- la précarité des conditions sanitaires est en autre la cause du choléra et de la tuberculose. Les zones que nous pouvons voir sur la carte ci-dessous sont celles où les virus émergents possèdent des capacités importantes de recombinaisons et de réassortiments génétiques ce qui favorise les mutations et ouvre la voie à des infections humaines. Ces villes ont souvent des conditions sanitaires minimales et sont ainsi propices à l’amplification des épidémies. Bien que les campagnes comptent beaucoup de paysans pauvres, c’est dans les villes que l’on retrouve les populations les plus défavorisées, en effet près d'un milliard d’êtres humains vivent dans des bidonvilles. De nouvelles ou anciennes pathologies apparaissent dans les quartiers défavorisés ou les bidonvilles, n’épargnant que les catégories les plus aisées.
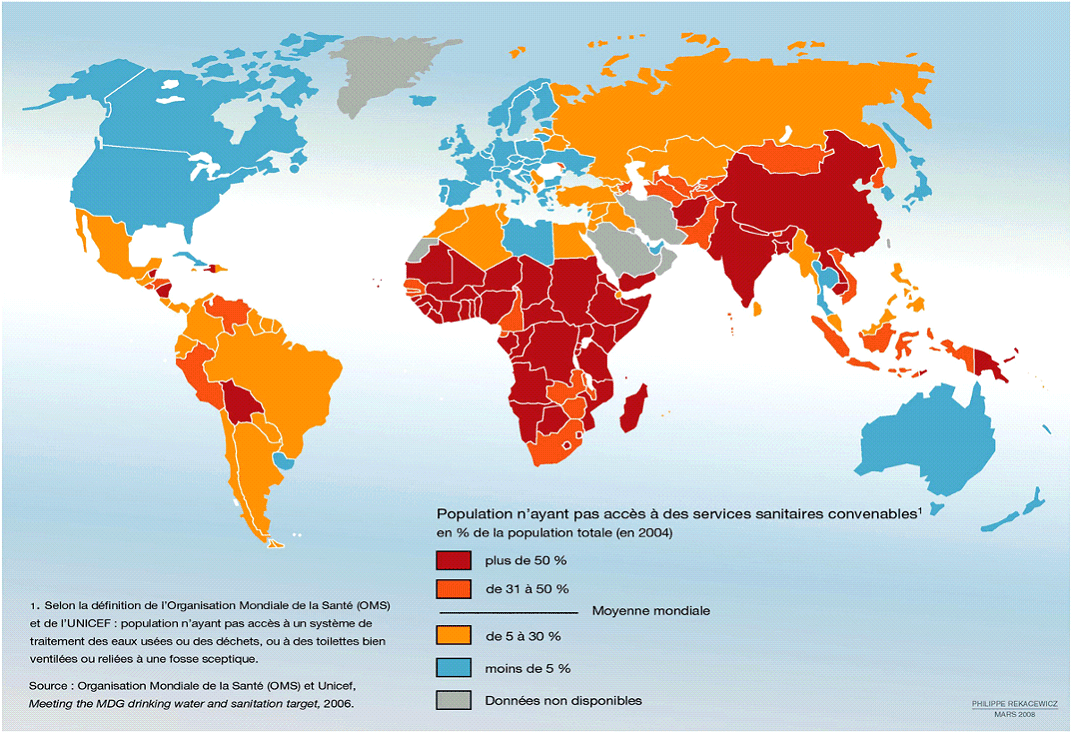
POPULATION N’AYANT PAS ACCES A DES SERVICES SANITAIRES CONVENABLES
- les conditions liées à l’hôpital ou à des erreurs de soins et de pratiques médicales, par exemple les maladies nosocomiales qui se transmettent par contact direct d’un malade à un autre, par l’air, par le personnel, par des objets, c’est l’infection croisée ou une infection due aux microbes qui existent normalement dans un organisme, sans y avoir jusqu'alors provoqué de troubles (ces germes deviennent virulents lorsqu'il y a une diminution de résistance de l'organisme), c’est l’auto-infection.
- l’évolution des agents pathogènes, notamment la résistance aux antibiotiques (vu plus haut)
- la contamination par les aliments ou l’eau qui est la cause de l’émergence de la bactérie Escherichia coli
- les voyages et échanges humains intercontinentaux sont la source de la grippe saisonnière. En effet, les modes de transport (voitures, trains, etc..) sont des moyens d’expansion des pathogènes comme nous l’avons vu précédemment.
- la désorganisation des systèmes de santé et de surveillance a provoqué la maladie du sommeil en Afrique et la tuberculose en ex-URSS
- les transports économiques de biens commerciaux et d’animaux sont une des causes du virus H5N. En 1956 les méthodes de transport ont été modifiées suite à l’invention du containeur. Par exemple, 1 000 porte-conteneurs passent chaque jour par le détroit de Gibraltar ce qui reflète l’ampleur prise par le commerce international et l’importance du trafic maritime pour le transport de marchandises. Cependant, après l’émergence d’une nouvelle maladie, ces échanges par voies aérienne ou maritime sont à l’origine de la diffusion du pathogène.
- les changements climatiques sont une ces causes du paludisme en Afrique de l’Est. En effet, le réchauffement climatique atténue les contrastes entre les différentes régions du globe ce qui favorise l’implantation de vecteurs ou de nouveaux pathogènes sur des milieux jusqu’alors indemnes de certaines pathologies comme le Chikingunya en Europe. Cependant, le lien direct entre l’apparition de nouvelles maladies et le changement climatique n’est pas établi même si ce facteur joue un rôle dans l’orientation des autres facteurs tels que le mode de vie, les conditions d’exploitations des sols, etc… En revanche la multiplication de certains vecteurs (moustiques, tiques, etc..) et leur pullulation à la suite de certains évèments climatiques est certainement à l’origine de l’apparition de nouvelles maladies animales. C’est donc par le lien direct entre santé animale et santé humaine que le facteur climatique joue un rôle.
C’est bien connu, la mondialisation favorise la venue de nouvelles maladies, d’un continent à un autre et en très peu de temps. Il suffit parfois de quelques jours pour qu’une maladie se propage, et encore moins pour qu’elle sème la panique. C’est le cas par exemple de la coqueluche, de la gale, de la rougeole et de la tuberculose qui ont réapparu depuis ces dernières années. Cette dernière a émergé il y a près de 7 000 ans dans une région comprise entre le Nord-Est de la Chine, la Corée et le Japon et elle s’est propagée dans le reste du monde par vagues successives associées à des mouvements de population humaine. A l’époque contemporaine, la population bactérienne a d’abord vu ses effectifs s’accroître lors de la révolution industrielle et de la première guerre mondiale, ces phases d’expansion étant vraisemblablement liées à l’augmentation de la densité humaine et aux privations respectivement associées à ces épisodes. L’unique phase de décrue observée ensuite concorde avec l’utilisation généralisée des antibiotiques dans les années 60. Ce déclin s’est interrompu à la fin des années 80, en lien avec l’épidémie de sida et avec l’apparition de la multi-résistance aux antibiotiques. L’étude a également montré que deux souches plus particulièrement associées à cette multi-résistance ont commencé à se propager de façon épidémique en Asie centrale ainsi qu’en Europe de l’Est à une époque récente coïncidant avec l’effondrement du système de santé publique en ex-URSS. Ces résultats soulignent l’importance de maintenir le système de lutte contre la maladie au plus haut niveau d’efficacité. Mais comment pouvons-nous expliquer la persistance de cette maladie pour laquelle il existe un vaccin, des traitements et que l’on aurait pu croire endiguée en France ? La résurgence de la tuberculose est révélatrice d'une précarité très forte. On sait que la promiscuité, les conditions de vie déplorables, les difficultés d'accès au logement, à une eau de bonne qualité, les variations de chaleur, etc., favorisent le développement de la tuberculose. Plus inquiétant encore, elle est en hausse régulière depuis début 2000.
Ainsi, l’émergence ou/et la résurgence de maladies infectieuses est due à de nombreux facteurs qui sont tous liés, certains plus étroitement que d’autres, à la mondialisation. Ce phénomène existe depuis déjà bien longtemps mais aujourd’hui il a pris une ampleur considérable que nous ne maîtrisons plus. En effet, nous sommes sans cesse exposés à de nouvelles maladies ou à d’anciennes maladies qui ressurgissent et que nous n’arrivons pas à traiter ou à éviter. C’est pourquoi de nouvelles mesures ont besoin d’être prises afin d’éviter au maximum l’apparition de nouvelles pandémies qui pourraient s’avérer dévastatrices.